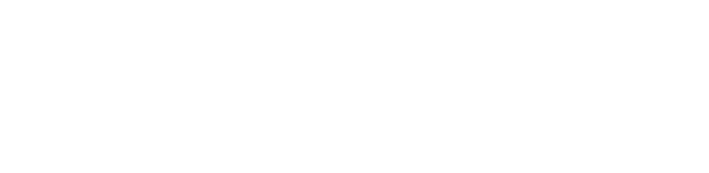Interdiction de territoire et lettre d'équité procédurale
La réception d’un avis d’interdiction de territoire doit être prise très au sérieux. Si tel est votre cas, nous vous recommandons d’obtenir l’aide de professionnels immédiatement.
Interdictions de territoire
L’interdiction de territoire désigne les mesures prises par les autorités canadiennes pour restreindre l’accès ou la présence de certaines personnes sur le territoire canadien. L’interdiction peut être temporaire ou permanente.
Les motifs les plus courants d’interdiction de territoire sont les suivants :
Au Canada, une personne peut se voir refuser l’entrée ou être expulsée du pays si elle représente une menace à la sécurité nationale. Cette mesure vise à protéger le public et à préserver l’ordre public et la stabilité des institutions.
Cela peut inclure des activités telles que le terrorisme, l’espionnage, la subversion ou la tentative de renverser un gouvernement par la force. Il est également possible d’être interdit de territoire en raison d’un soutien apporté à des groupes ou organisations associés à ce type d’actions, même sans y avoir participé directement.
L’évaluation se fait au cas par cas, en fonction de plusieurs facteurs comme l’implication personnelle, l’historique du pays d’origine et les renseignements disponibles. Une simple affiliation passée ou des gestes jugés menaçants peuvent être suffisants pour justifier une décision d’interdiction.
Les conséquences peuvent inclure un refus d’entrée, la perte de statut au Canada, une détention ou un renvoi du pays. Ces décisions peuvent avoir un impact majeur sur la vie personnelle, familiale et professionnelle des personnes concernées.
Le Canada refuse l’entrée à toute personne impliquée dans de graves violations des droits humains ou du droit international. Ce motif d’interdiction s’inscrit dans l’engagement du pays à promouvoir la justice, la paix et la protection des droits fondamentaux.
Cela comprend notamment les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide, la torture ou la persécution. L’interdiction peut également viser les personnes qui ont occupé des postes de responsabilité dans des régimes ou des organisations ayant commis de tels actes, même si elles n’ont pas été directement impliquées.
Les autorités prennent en compte le rôle de la personne, le contexte historique et les faits établis. Des documents officiels, des rapports internationaux ou des antécédents politiques peuvent être utilisés pour appuyer une telle décision.
Les conséquences peuvent inclure un refus d’admission, l’annulation de documents d’immigration ou une expulsion. Il s’agit d’une mesure grave, qui reflète la volonté du Canada de ne pas offrir d’asile aux responsables ou complices de violations fondamentales des droits humains.
Au Canada, une personne peut être interdite de territoire si elle a été reconnue coupable de certaines infractions criminelles, que ce soit au Canada ou à l’étranger. Trois grandes catégories peuvent mener à l’interdiction : la criminalité, la grande criminalité et la criminalité organisée.
La grande criminalité désigne les infractions passibles d’une peine maximale de dix ans ou plus en vertu du droit canadien. Cela inclut des actes comme les agressions graves, les fraudes importantes, le trafic de drogues ou d’armes, ainsi que la conduite avec facultés affaiblies (alcool ou drogues). Même si ce type d’infraction est parfois perçu comme mineur ailleurs, il est considéré comme très sérieux au Canada et peut entraîner une interdiction de territoire, y compris pour les résidents permanents.
La criminalité couvre les infractions moins graves, comme le vol simple ou certaines voies de fait. Une seule condamnation peut suffire à rendre une personne inadmissible.
La criminalité organisée fait référence à la participation, directe ou indirecte, à des activités d’un groupe criminel organisé, notamment le blanchiment d’argent, la traite de personnes, ou encore la contrebande à grande échelle. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir été formellement condamné pour être interdit de territoire sur cette base.
L’évaluation repose sur la nature de l’infraction, la peine encourue, les circonstances et les liens présumés avec des activités criminelles. Ces motifs peuvent empêcher l’entrée au Canada ou entraîner le renvoi d’une personne qui y réside déjà.
D’autres motifs peuvent rendre une personne inadmissible:
Motifs sanitaires
L’entrée au Canada peut être refusée à une personne dont l’état de santé représente un danger pour la santé ou la sécurité publique. Cela peut inclure certaines maladies contagieuses ou des troubles de santé mentale associés à des comportements dangereux. De plus, une personne peut être jugée inadmissible si son état de santé risque d’imposer un fardeau excessif au système de santé ou aux services sociaux canadiens.
Motifs financiers
Pour être admis au Canada à titre temporaire, il faut démontrer qu’on dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour. En l’absence de preuve de capacité financière, une personne peut être déclarée inadmissible pour motifs financiers.
Fausses déclarations
Fournir de fausses informations, cacher des faits importants ou présenter des documents frauduleux dans le cadre d’une demande peut entraîner une interdiction de territoire. Cette interdiction peut s’appliquer même si la fausse déclaration était involontaire, et elle peut durer plusieurs années.
Manquement à la loi
Ne pas respecter les conditions d’un visa ou d’un permis peut mener à une interdiction. Cela comprend, entre autres, le fait de rester au Canada après l’expiration de son statut, de travailler ou d’étudier sans autorisation, ou de contrevenir à une condition imposée.
Inadmissibilité familiale
Dans certains cas, une personne peut être déclarée inadmissible simplement parce qu’un membre de sa famille proche l’est. Par exemple, si un conjoint ou un enfant est inadmissible pour des motifs de santé, de sécurité ou de criminalité, cela peut affecter toute la demande. L’admissibilité au Canada est donc parfois évaluée à l’échelle familiale.
Lettre d'équité procédurale
Si les autorités canadiennes identifient un problème dans votre demande d’immigration, elles peuvent vous envoyer une Lettre d’Équité Procédurale (LEP). Cette lettre, émise par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), fait partie du processus d’évaluation des demandes. Elle vise à garantir que le demandeur ait la possibilité de se faire entendre avant qu’une décision défavorable ne soit rendue.
La LEP expose généralement les préoccupations précises des agents d’immigration concernant votre dossier. Elle peut inclure des références à la loi, aux règlements ou aux politiques internes. Vous y trouverez une description détaillée des éléments problématiques, ainsi que la possibilité de fournir des explications, documents ou preuves pour répondre aux inquiétudes soulevées.
Recevoir une LEP est un signal d’alarme qu’il faut prendre très au sérieux. Dans la majorité des cas, cela signifie que l’IRCC envisage de refuser votre demande. Votre réponse constitue donc votre seule et unique chance de convaincre les autorités d’accepter votre dossier. Une réponse incomplète ou peu convaincante entraîne souvent un refus, et dans certains cas, peut même entraîner une interdiction de territoire de cinq ans, vous empêchant de présenter une nouvelle demande dans l’immédiat.
Il est possible de répondre seul à une LEP, mais il est fortement recommandé de consulter un avocat en immigration. La complexité du droit de l’immigration et les conséquences juridiques d’un refus rendent cette étape cruciale. Un avocat expérimenté saura analyser les préoccupations soulevées, rassembler les preuves appropriées et formuler une réponse convaincante, claire et conforme aux attentes des autorités.
Chez Giroux O’Connor Immigration Law, nous comprenons l’importance de chaque dossier. Si vous avez reçu une LEP, notre équipe est prête à vous accompagner, à défendre votre position et à maximiser vos chances de succès.